Dans notre environnement technologique, nous ne percevons plus le lien entre les aliments que nous mangeons et les récoltes qui les produisent. On parle de « cécité botanique » et c’est un phénomène menaçant.
IL Y A QUELQUES ANNÉES, JE ME SUIS intéressée au Projet Eden, en Cornouailles, R.-U., dans le cadre d’une recherche pour un livre. Pendant près de 160 ans, le site était une carrière d’où l’on extrayait de l’argile blanche pour produire de la porcelaine de Cornouailles, jusqu’à l’épuisement du gisement. Aujourd’hui, près de 20 ans plus tard, on la transforme en un vaste et vibrant jardin, évoquant le lieu biblique d’où elle tire son nom.
“Plant blindness” refers to the fact that many humans don’t recognize that we depend on plants for survival.
~Alanna Mitchell
Le jardin comprend environ 12 hectares de plantes, certaines logées dans des dômes géodésiques, qui fonctionnent comme des écosystèmes complexes, par exemple la forêt pluviale tropicale. Le jardin rassemble près de 2 millions de plantes. Le site est spectaculaire, surgissant d’une vallée de Cornouailles comme une enfilade de bulles géantes appuyées sur les collines. Mais plutôt que le coup d’oeil, c’est une histoire que j’y ai entendue qui m’a frappée.

Peu après l’inauguration de l’Eden, les groupes scolaires commencèrent à le visiter et à s’émerveiller devant les plantes. Des fleurs étranges se multipliant dans ce qui ressemblait — pour des petits Britanniques — à un sauna. Des formes et des textures qui donnaient l’impression d’arriver d’une autre planète. Les enfants étaient envoûtés.
Puis, l’un de ces enfants se trouva confronté à un phénomène qu’il ne pouvait tout simplement comprendre. C’était une orange, qui poussait sur un arbre. L’enfant protestait : c’est une tricherie, quelqu’un a collé l’orange sur la branche. Les oranges ne poussent pas dans les arbres; elles proviennent du supermarché.
C’est un exemple typique d’un phénomène que nous appelons « cécité botanique » ou indifférence aux plantes. L’expression, apparue en 1998, réfère au fait que beaucoup d’humains ne sont plus conscients que nous dépendons des plantes pour notre survie. C’est une idée relativement nouvelle et qui fascine par sa bizarrerie. Considérons le fait que, pour la majeure partie des 10 000 dernières années, l’obsession d’amener les plantes à se comporter selon nos désirs a mobilisé énormément de temps et d’énergie. L’innovation horticole était considérée comme tout à fait honorable et un préalable essentiel de la civilisation humaine.
Nous avons amené les plantes à nous fournir des graines plus grosses et plus faciles à faire pousser. Ou alors, nous avons hybridé soigneusement différents caractères pour obtenir des fruits qui se conserveraient pour l’hiver, qui attireraient moins les parasites ou qui nous procureraient plus d’énergie.
Nous en avons un exemple fameux avec le maïs. Son ancêtre était une graminée sauvage, la téosinte, avec de petits épis recouvrant de minuscules grains protégés par une coquille dure. Il y a plusieurs milliers d’années, des fermiers du Néolithique ont commencé à sélectionner les grains les plus sucrés pour les replanter, en pinçant les tiges supplémentaires pour obtenir des boutons fructifères plus gros. Avec les millénaires, nous en sommes arrivés aux gros épis sucrés que nous chérissons aujourd’hui, à griller ou à faire bouillir…

En fait, la base de la civilisation humaine repose sur ces connaissances : quoi planter? où? quand? et quand le récolter?
On constate aujourd’hui une « déconnexion » inquiétante, selon un article de Tara Moreau du jardin botanique de l’Université de Colombie-Britannique, paru il y a quelques mois dans la revue Plants, People, Planet. Vers 1880, la moitié de la population des États-Unis était en lien avec l’activité agricole. Aujourd’hui, c’est seulement deux pour cent, alors que la majorité d’entre nous vivons en milieu urbain, tandis qu’une grande proportion des récoltes sont destinées à être transformées en substances dont l’origine botanique n’est plus visible : sirops, farines, huiles et fécules.
Ces gros épis de maïs, par exemple, sont tellement omniprésents et transformés en tant d’autres substances qu’un quart des quelque 45 000 produits disponibles dans une grande surface typique en contient, selon le chroniqueur Michael Pollan. Cela comprend les couches et le dentifrice.
Le problème, c’est que nous n’accordons pas de valeur à ce que nous ne voyons pas. Avec les changements climatiques, la culture des plantes alimentaires deviendra de plus en plus importante, selon Moreau et ses coauteurs. Et plus complexe aussi. L’enjeu est lié à plusieurs autres impératifs contemporains : restaurer les sols, conserver l’eau, nourrir une population en croissance, protéger les pollinisateurs et réduire les émissions de GES.
Les auteurs suggèrent de revenir au jardin. Cela implique d’utiliser les jardins botaniques comme le Projet Eden ou celui de l’UCB, ou n’importe laquelle des 3500 institutions similaires dans le monde, pour éduquer le public sur l’apport des plantes dans notre mode de vie. C’est une tentative pour aider les humains à réapprendre le concept que les plantes nous nourrissent, et que nous en avons besoin.

Peut-être que l’attirance des humains pour les plantes n’est pas complètement perdue. Moreau et ses collègues observent que toutes les grandes métropoles du monde possèdent un grand jardin public — ou qu’il s’en trouve un à proximité. Il en existe sur tous les continents, sauf en Antarctique. Déjà, ces conservatoires attirent 250 millions de visiteurs chaque année, dont la majorité vit dans des jungles de béton.
Du côté du Projet Eden, j’ai vérifié récemment. Cette carrière épuisée est devenue une attraction touristique majeure en Grande-Bretagne, avec plus d’un million de visiteurs par année. C’est deux fois plus que le palais de Buckingham.
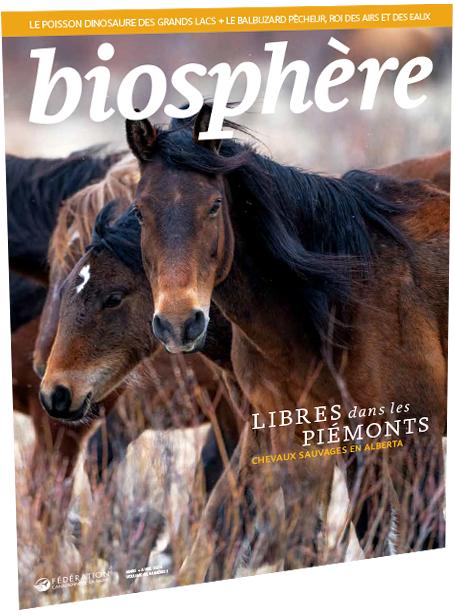
Tiré du magazine Biosphère. Pour découvrir le magazine, cliquez ici. Pour vous abonner à la version imprimée ou numérique ou bien acheter le dernier numéro, cliquez ici.





