En mars 2025, un groupe de détenteurs du savoir, de gardiens autochtones et de praticiens du domaine de la conservation provenant de partout au Canada s’est réuni à Antigonish et sur le territoire de la Première Nation Paqtnkek.
La rencontre, à la fois pratique culturelle et échange de connaissances, portait sur l’anguille d’Amérique (Anguilla rostrata), appelée « pimizi » en algonquin-anichinabemowin.
Cette rencontre faisait suite aux relations établies et aux idées exprimées lors de la conférence sur le rétablissement du pimizi organisée par la Première Nation de Kitigan Zibi à Maniwaki en septembre 2024. Le but de la visite était d’apprendre des leaders mi’kmaq les méthodes traditionnelles de pêche, les savoirs écologiques et juridiques, ainsi que la signification culturelle de l’anguille, tout en explorant le potentiel de mettre sur pied des initiatives de rétablissement interrégionales dirigées par des Autochtones.
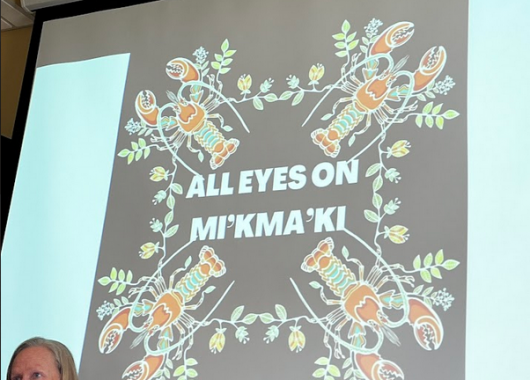
Parmi les participants se trouvaient des représentants de la Première Nation Kitigan Zibi, de la Première Nation de Timiskaming, de la Première Nation de Kebaowek, de la bande des Mohawks de Akwesasne, de la Première Nation de Hiawatha, de l’Institut des sciences environnementales du fleuve Saint-Laurent et de la Fédération canadienne de la faune. Le rassemblement a été organisé par Jane McMillan, Ph.d., et l’Aîné résident à l’Université St Francis Xavier, Kerry Prosper. Ces derniers ont été appuyés par le personnel de l’Unama’ki Institute of Natural Resources et de membres de la communauté mi’kmaq.

mention de source : Stephany Hildebrand
Les activités comprenaient une séance de bienvenue et une discussion avec le personnel de l’Unama’ki Institute of Natural Resources et de l’Université St Francis Xavier), ainsi que des visites de sites locaux de pêche à l’anguille, dont l’endroit où Donald Marshall Jr. a été arrêté — un événement qui a mené à une décision phare de la Cour suprême sur les droits issus des traités des Mi’kmaq. Les participants ont aussi pris part à une expérience pratique avec l’aîné Kerry Prosper, qui a généreusement partagé ses connaissances sur les harpons à anguille, le cuir d’anguille et les techniques de préparation. Il a effectivement guidé le groupe alors qu’il apprenait à écharner, fileter et cuisiner l’anguille. Aaron Prosper a offert un exposé riche et instructif sur l’histoire des relations issues des traités en Mi’kma’ki et a parlé de la mise en œuvre contemporaine de la gouvernance, des droits et des relations mi’kmaq selon l’interprétation des traités. Son intervention a abordé les premiers contacts avec les Européens et décrit l’esprit véritable et l’intention des traités de paix et d’amitié. Les repas partagés entre les participants et les hôtes et les récits oraux racontés tout au long du séjour ont favorisé d’importants échanges.
La visite a suscité de nombreuses réflexions :
« Le séjour en Mi’kma’ki a été une expérience marquante et révélatrice. Il était centré sur l’apprentissage du lien profond que les peuples mi’kmaq et algonquin entretiennent tous deux avec l’anguille d’Amérique. Pendant que nous y étions, nous avons eu le privilège d’en apprendre davantage sur les traités conclus entre les Mi’kmaq et la Couronne, et sur la façon dont ces accords historiques continuent de façonner et de mettre à l’épreuve leurs luttes actuelles pour les droits de récolte. Entendre parler de la décision Donald Marshall par des personnes qui le connaissaient personnellement a ajouté une dimension percutante à ce que je n’avais jusque-là rencontré que dans un cadre académique. Ça m’a rappelé à quel point ces batailles juridiques sont intimement liées à la vie et au bien-être de personnes et de communautés réelles. Ce qui m’a le plus marquée, c’est la force et la générosité d’esprit des gens que nous avons rencontrés. Malgré les défis persistants au sein de leur nation et avec des forces extérieures, ils nous ont accueillis et transmis leur savoir avec beaucoup de soin et de fierté, témoignage de la résilience que partagent nos nations. En cela, nous n’avons pas de meilleur enseignant que l’anguille. Je suis très reconnaissante d’avoir vécu cette expérience et d’avoir appris de l’anguille aux côtés de nos frères et sœurs mi’kmaq. »
- Melodie Hurtubise, Première Nation de Timiskaming
« Je suis très reconnaissante d’avoir eu l’occasion de voyager pour rencontrer nos proches de l’Est, en Mi’kma’ki. Leurs connaissances sur l’anguille étaient inspirantes. Ils nous ont fourni un exemple à suivre en nous montrant comment ils naviguent dans la société occidentale tout en demeurant fermement attachés à leurs valeurs traditionnelles. Cette expérience a mis en lumière à quel point le pimizi est important pour toutes les personnes qui ont dépendu des réseaux fluviaux partout dans l’est du Canada. Il me semble que l’anguille est la représentation même de la communauté et de l’unité. Tout comme elle voyage en groupe, elle rassemble les gens. Sa résilience, sa capacité d’adaptation et son unicité incarnent directement les peuples des Premières Nations sur ce territoire. J’ai encore beaucoup à apprendre au sujet de ce membre de notre grande famille. Miigwetch. »
- Dolcy Meness, Kitigan Zibi Anishinabeg
« En repensant à notre récent voyage à Antigonish, nous ressentons une profonde gratitude pour l’occasion qui nous a été donnée de tisser des liens avec la communauté mi’kmaq et de mieux comprendre l’importance culturelle et historique de l’anguille. Cette expérience a été un puissant rappel de la résilience et de la force des peuples autochtones, ainsi que de leur lien profond avec la terre, ses ressources et les multiples formes de vie qui la partagent. Les récits que nous avons entendus, les traditions que nous avons découvertes et les savoirs qui nous ont été transmis ont renforcé notre reconnaissance de l’importance de préserver et de respecter les pratiques autochtones. Nous sommes honorés d’avoir été invités à prendre part à cette expérience, et nous repartons avec un engagement renouvelé à soutenir les communautés autochtones dans leur lutte continue pour la justice, la préservation culturelle et la protection de l’anguille. Cette expérience nous a rappelé la nécessité d’une plus grande sensibilité culturelle et l’importance de continuer à écouter, à apprendre des voix autochtones et à nouer des liens avec ces peuples. »
- Sarah Sra et Nick Lapointe, Fédération canadienne de la faune
« La première fois que j’ai vu une anguille, c’était lorsque ma famille s’est installée à Cornwall, en Ontario, au milieu des années 1990. Je me souviens distinctement avoir vu des anguilles découpées sur le rivage, à peu près à la même période où les raisins sauvages étaient mûrs. Ce n’est que plus tard dans ma vie que j’ai appris la vérité : depuis la construction du barrage Moses-Saunders, les anguilles sont tuées à un rythme alarmant par les turbines. On estime que de 23 à 25% d’entre elles périssent chaque année en tentant de retourner frayer dans la mer des Sargasses — un voyage essentiel que l’espèce accomplit depuis des millénaires. Et à environ 100 km en aval, au barrage de Beauharnois, nous en perdons un autre 23 à 25 %. Bien que ces chiffres et la réalité de la situation soient abondamment documentés dans des études scientifiques, l’espèce n’est pas largement connue du grand public. À moins de passer beaucoup de temps sur l’eau ou d’être un Aîné, on peut même ignorer que des anguilles habitent encore dans le fleuve. Au cours des dernières années, je suis devenue profondément fasciné par les anguilles et leur histoire. J’ai eu le privilège d’apprendre auprès d’Akwesasronon l’importance de l’anguille pour la communauté, à la fois comme remède et comme source alimentaire autrefois vitale. Je ne peux qu’imaginer le profond sentiment de perte ressenti par ceux qui dépendaient de ce cousin aquatique. Qu’est-ce que ce devait être que de les voir s’échouer mortes sur les rives de leurs propres arrière-cours, puis de constater leur disparition éventuelle? En 2022, des personnes de la région ont communiqué avec l’Institut des sciences environnementales du fleuve Saint-Laurent, un organisme sans but lucratif situé sur les rives du Saint-Laurent, à Cornwall, pour signaler la présence de centaines d’anguilles mortes au fond du fleuve. Une équipe de scientifiques, de techniciens et moi-même (à titre de photographe et de communicatrice scientifique) sommes partis en bateau pour enquêter. Le choc que nous avons ressenti en voyant la situation de nos propres yeux a été accablant. Nous savions que des anguilles mortes étaient signalées, mais rien ne nous avait préparés à la réalité terrifiante à laquelle nous avons été confrontés. Des centaines d’anguilles jonchaient le lit du fleuve, mais ce qui rendait la scène encore plus déchirante, c’est que plusieurs n’étaient pas complètement mortes — certaines étaient paralysées, d’autres blessées mais encore vivantes, se tordant de douleur. Les scientifiques croient que ces anguilles proviennent probablement d’un programme d’empoissonnement lancé dans les années 2000 pour rétablir la population dans le fleuve Saint-Laurent. Pour des raisons encore mal comprises, les anguilles issues de l’empoissonnement ont tendance à migrer plusieurs mois plus tard que leurs congénères sauvages. À bien des égards, ces anguilles, ainsi que les amas tragiques de poissons morts ou souffrants, sont devenues un symbole à la fois d’espoir et d’urgence — un rappel que nous avons une autre chance de changer les choses et de partager leur histoire.
Avançons jusqu’en 2025, quand Leora m’a invitée à participer à un voyage pour en apprendre davantage sur les anguilles selon la perspective mi’kmaq. Mon ami Abraham Francis m’a accompagnée pour représenter le fleuve Saint-Laurent. Pour moi, l’expérience a mis en lumière les degrés variables de perte ressentis par les communautés autochtones face à l’anguille. Pour les Algonquins, la déconnexion avec l’anguille s’étend sur plusieurs générations. Autrefois, les anguilles étaient aussi abondantes et significatives dans le bassin versant de la rivière des Outaouais que dans le Saint-Laurent, mais aujourd’hui, peu de gens savent qu’elles ont déjà existé sur ce territoire. J’ai pu constater à quel point la trajectoire de ce que nous vivons sur le Saint-Laurent pourrait faire écho aux pertes ressenties par les Algonquins. Pour les Mi’kmaq, qui pêchent encore activement l’anguille, le déclin des populations est devenu de plus en plus marqué. L’histoire de Donald Marshall Jr. et du harcèlement que lui et sa partenaire, Jane McMillan, ont subi de la part du gouvernement m’a rappelé l’importance des liens communautaires et des récits. Je n’ai pu m’empêcher de réfléchir au fait qu’un seul pêcheur et sa partenaire ont dû endurer tant d’épreuves, alors que les industries responsables d’une grande partie de ces pertes sont demeurées largement non réglementées et exemptées d’adopter des mesures concrètes pour protéger l’espèce. J’ai senti à quel point ce rassemblement était puissant pour l’échange de savoirs et la mise en place d’assises pour de futurs efforts d’organismes en faveur de l’anguille. Le rythme de la rencontre était lent, avec un horaire souple qui permettait de créer des liens et de bâtir des relations. Même si la perte et le deuil demeurent bien présents, cette rencontre a été porteuse d’espoir, positive et, pour moi (et peut-être pour d’autres aussi), guérissante.
Comme l’a dit Leora, les anguilles sont une espèce qui unit — et elles le sont véritablement. »
- Stephany Hildebrand, l’Institut des sciences environnementales du fleuve Saint-Laurent
Cet échange de savoirs a été rendu possible grâce à l’appui du Conservation Through Reconciliation Partnership et de l’Université de Guelph (avec un financement obtenu par Leora et administré par le Cooke Lab de l’Université Carleton), de la Lenfest Foundation par l’entremise de Jane McMillan, ainsi que de la Fédération canadienne de la faune.
Nous remercions toutes les personnes qui ont partagé leur temps, leurs récits et leurs enseignements — et au pimizi, ce proche dont le parcours continue de guider et de relier les communautés d’un bout à l’autre de l’Île de la Tortue.
Le Conservation Through Reconciliation Partnership a offert un soutien financier à des étudiants autochtones et des chercheurs postdoctoraux qui mènent des projets communautaires de conservation et de recherche. Pour en savoir plus sur leur travail : conservation-reconciliation.ca.





