La peur est un puissant moteur de la biologie. Et ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose
En 2010, un biologiste du nom de John Laundré a été l’auteur principal d’un article universitaire qui utilisait le terme « paysage de la peur » pour décrire la façon dont un animal (et par extension un collectif d’animaux) évalue et appréhende son environnement immédiat. Dans ce contexte, la peur est une anticipation ou une prise de conscience du danger, ce qui signifie que la notion décrit essentiellement une analyse risque-récompense innée complexe qui met dans la balance la recherche de nourriture et la sécurité contre la prédation. L’idée a depuis été adoptée par beaucoup et, dix ans plus tard, elle semble être une construction adaptée à nos réalités virales, écologiques et politiques actuelles.
Le paysage de la peur, disent Laundré et d’autres, décrit le calcul que tous les animaux doivent faire et ce faisant, définit comment les animaux « voient » leur monde. L’écureuil gris de votre parc local doit constamment évaluer les conditions changeantes. En fonction de l’endroit précis où il se trouve, il crée une carte multidimensionnelle des innombrables menaces qui pèsent sur sa survie. L’écureuil surveille ses propres besoins et déficits caloriques et localise les zones sûres et les zones stériles et d’abondance en identifiant les dangers sur une courte et longue période : les secondes qu’il faut à l’autour des palombes affamé pour survoler, la durée d’un violent orage, le cycle dangereux des lunes gibbeuses, l’approche de la météo difficile d’une saison. Il projette ensuite sa recherche de nourriture, en équilibrant le besoin du moment et le risque — comment manger sans être mangé.
Avec l’arrivée de la COVID-19, ces paysages ont pris de nouveaux contours : la faune urbaine s’est déplacée ouvertement dans les rues des villes, car elle a perçu une réduction majeure de la menace de l’homme, en équilibre avec la nécessité de chercher agressivement pour remplacer les sources urbaines habituelles de subsistance, comme les ordures, qui se sont taries.
Les humains aussi ont redessiné leurs cartes. En quelques semaines seulement, les aspects les plus banals et les plus ordinaires de notre existence sont devenus des dangers mortels. Des actes autrefois routiniers — faire les courses, prendre les transports en commun ou simplement se rendre au travail — ont pris l’allure d’une expédition en territoire dangereux où un prédateur de l’ombre pourrait être à l’affût. Les risques étaient si élevés que nous avons évité les restaurants et les bars, nous avons évité de fréquenter nos amis et notre famille, nous avons abandonné notre vie normale. Tous ceux qui pouvaient rentrer chez eux — et y rester — l’ont fait. L’arrêt mondial des activités humaines qui s’en est suivi, surnommé « anthropause » dans un article récent d’un groupe international de chercheurs sur la COVID-19, a reflété les changements radicaux de nos comportements collectifs.
À partir du printemps, en tant que service public, Alphabet inc. (la société mère de Google) a commencé à publier des « rapports sur la mobilité des communautés », des données de localisation des utilisateurs normalement regroupées dans Google Maps pour obtenir des informations de dernière minute sur la circulation et la popularité des destinations. Ces données anonymes et agrégées permettent de voir comment les comportements des communautés ont changé avec l’arrivée de la COVID-19 et à quelle vitesse cela s’est produit.
Un très grand pourcentage d’entre nous s’est tourné vers la nature, vers le plein air.
Qu’ont fait les citadins canadiens face à cette catastrophe? Eh bien, un très grand pourcentage d’entre nous s’est tourné vers la nature, vers le plein air. Les données de Google sont sans équivoque : en avril, les activités dites récréatives (magasinage, restaurants, cinéma — c’est-à-dire la consommation) avaient diminué à moins de 10 % de leur niveau dans une année normale; et à partir de mai, avec l’arrivée du beau temps, le nombre de personnes passant du temps dans les parcs et espaces verts locaux a augmenté d’environ 300 % dans les zones urbaines et suburbaines du pays. Les parcs provinciaux et nationaux ont connu des augmentations similaires à l’approche de l’été.

L’expérience nous a donné un aperçu de notre capacité à apporter des réponses urgentes et pratiques au remodelage soudain de notre paysage de la peur. En tant qu’individus et en tant que société, nous avons rééquilibré les besoins et les devoirs de la vie quotidienne (y compris les contacts humains) contre la perspective de tomber malade, d’être contraints de s’isoler de nos proches et de voir le système de santé débordé, l’économie s’effondrer et les moyens de subsistance disparaître. Cela devrait nous donner des raisons d’être optimistes pour l’avenir. Néanmoins, parmi les nombreuses questions qui restent à résoudre alors que nous entrons dans la deuxième année de vie avec la COVID-19, nous devons nous assurer d’examiner comment nos angoisses collectives ont changé, comment nos propres paysages de peur ont été transformés avec elles, et ce que nous avons appris en conséquence.
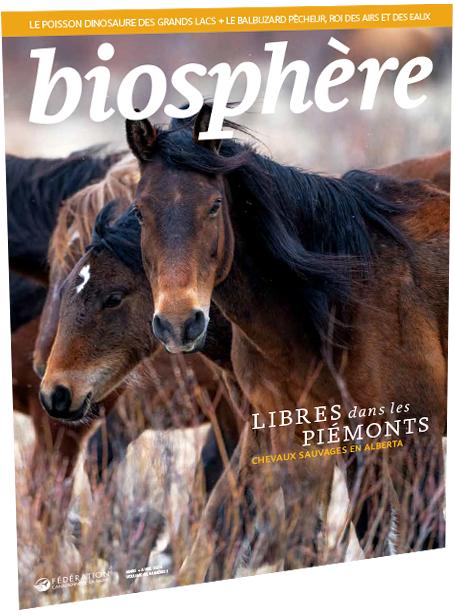
Tiré du magazine Biosphère. Pour découvrir le magazine, cliquez ici. Pour vous abonner à la version imprimée ou numérique ou bien acheter le dernier numéro, cliquez ici.





